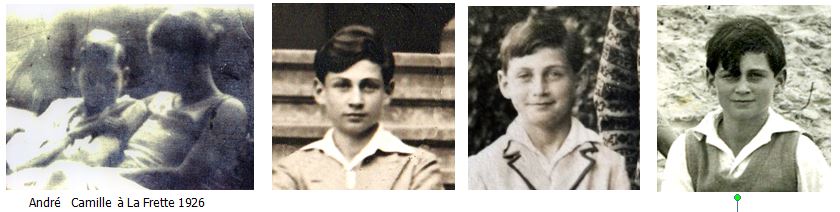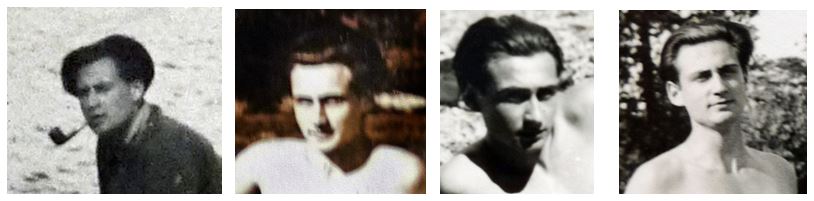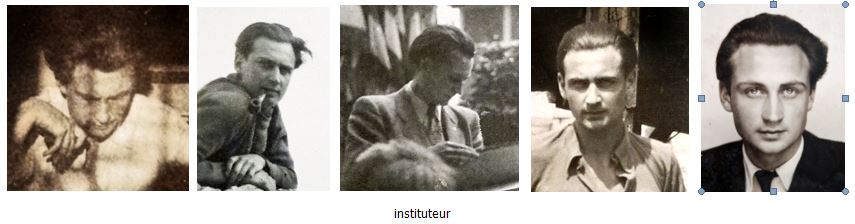Le cahier d’écolier rayé de bleu-blanc-rouge verticalement, porte un macaron en haut à droite où s’affichent Mickey et Minnie se hatant vers la gauche en habit révolutionnaire, Mickey brandissant un drapeau bleu blanc rouge sur lequel se lit en lettres bleues: liberté. Béatrice déduisit que les textes dataient donc de 1989 (André avait alors 73 ans), je suppose qu’ils sont en fait postérieures, autour de la période où je t’invitais à laisser qlq traces / reflexions sur ta vie, disons pour une consommation familiale, sincére et sans prétention (vers 1996 ? 80 ans), alors que je te voyais remplir des pages de notes beaucoup plus solennelles, ds ce modeste refuge du déclamatoire litterrarofilosofico, alors que comme Camille (sollicitée pareillement de ma part – de méme que toi, tu finissais par m’écrire 2 pages- il y a bien longtemps puisqu’à la naissance d’ Eloi en 1973, elle avait répondu que le trivial de la vie était sans intérêt. Récemment (24.1.98), Eloi et moi voulions t’interviewer, tes albums de fotos à l’appui, énnervé, tu déclarais avec emportement que parler de son enfance, sa vie, ça n’était pas la vie… Dont acte.)
Le texte suivant est donc tapé par mes soins le 14.03.2001 avec grande difficulté car j’éssai de réspecter l’ortografie originale, notamment les accents… On peut supposer que les changements de stylo (que j’indique) correspondent à des moments d’écriture différents. J’ai trouvé les textes trés intéréssants, correspondant bien au type de traces souhaitées, et l’exercice d’en découvrir le contenu en méme temps que j’en faisait la frappe était une bonne expérience de médiatisation / approche de tes souvenirs… Le témoignage réste pour l’instant très partiel. On en souhaiterait +, dépassant la petite enfance. Il ne réste plus à l’écolier qu’à se remettre au travail… au risque de rencontrer l’écrivain au passage, méme si en touriste un peu distant, car après tout ça n’apparaît pas comme une tare insurmontable que d’étre en état/complexe d’a-littérature. (a-pesanteur ?). (Didier BAY)
Ecrits d'André Bay
cahier . 1996 ? 80 ans
Mon inconscient ne doit pas conserver un bon souvenir de ma naissance.
D ’après ce qu’on m’en a dit le docteur avec ses forceps n’arriva qu’au bout de quarante huit heures alors que la mère et l’enfant avaient mis la sage-femme au désespoir. On m’extirpa tant bien que mal et plus mort que vif. Il fallut me fouetter rudement pour que je me décide a manifester en braillant mon entrée dans le monde. Je porte encore les marques des forceps et j’imagine qu’on remodèle un crane qui avait souffert pendant la traversée. C’était en septembre 1916 , dans un village de Normandie, à La Bonneville sur Ithon dans l’Eure.
Le médecin avait du faire 6 kilomètres, venant de Conches, en bicyclette pour arriver jusque là. Il paraît, et les photographies semblent le prouver, que j’étais ce qu’on appelle un « beau bébé » - compte tenu du fait que le plus laid des nouveau-nés sera toujours le plus beau pour ses parents, la nature ne manquant jamais une occasion de faire des aveugles pour arriver à ses fins.
Mes deux premières années furent j’imagine relativement heureuses suspendu aux seins de ma mère qui m’allaitait avec un plaisir certain semble-t-il. Par la suite elle me raconta qu’un jour, elle m’avait maladroitement laissé tomber sur le sol de toute sa hauteur et au lieu de me ramasser s’était mise à hurler: « Maman ! maman ! regarde s’il est cassé ! «
Je n’en garde aucun souvenir, pas même je crois dans mon inconscient. La psychanalyse permettrait-elle de résusciter ce genre d’incident? Aucun souvenir non plus de mon père qui était mobilisé à l’usine du village pour fabriquer des obus. Sans doute aimait-il me porter sur ses épaules ou me lancer en l’air, - sans me faire tomber. Mon grand-père et mon oncle faisaient la guerre, l’un dans la cavalerie l’autre dans les tanks, et j’imagine que la joie n’était pas toujours présente au foyer. Un beau jour néanmoins ce fut la fin de la guerre et le retour du grand-père et de l’oncle André dont je portais le prénom, ce qui donnait « Dédé » pour les intimes. Ce fut aussi le départ de mes parents pour Paris.
(Ici le bic noir est échangé contre un feutre noir ultra-fin)
Pourquoi ce soudain désir de remplir un cahier de souvenirs, fragments , résidus de mémoire. Peut-étre un besoin de me rassembler, de reconstituer, fut-ce par lambeaux, la trace d’une vie, la mienne, mais aussi sans doute, avec un peu de recul, celle de beaucoup d’autres à la même époque. Il me semble que j’ai passé une partie de ma vie, inconsciemment, à me constituer une personnalité en plus de celle que la nature m’avait donné. J’émergeais dans la vie avec d’infinies facultés d’émerveillement. Ce fut certainement un choc très dur pour le bébé que j’étais – deux ans – d’étre soudain laissé à ma seule grand-mère même si celle-ci m’aimait beaucoup.
Ainsi sommes nous constitués aussi de blessures oubliées. Car je ne me souviens guère de cette période. Si pourtant, la mort du grand-père – mais j’avais déjà cinq ans puisque c’était ma première année à l’école communale. Je me vois rentrant de l’école vers midi, ouvrant la porte qui donnait sur la cuisine-salle à manger où grand-mère est seule, comme toute blanche dans sa robe noire, le visage ravagé par l’insomnie et l’inquiétude, mains tremblantes sur son tablier. La porte qui donne sur la chambre de mes grands-parents est ouverte et je découvre qu’il y a autour du lit de grand-père ma mère, mon père –venus soudain de Paris – et mon oncle André. Mon entrée ne donne lieu à aucune embrassade, l’heure est lourde. Je vais m’asseoir spontanément sur un petit banc à moi réservé dans un coin de la pièce et je lève les yeux sur le visage de grand-mère qui trouve la force de me sourire. Soudain, j’entends la voix de grand-père, elle retentit encore en moi: « Mes bleus de travail, je veux aller travailler « pour parler et marquer sa résolution, le moribond s’est dressé sur son lit. Alors la voix de mon père: « Non père ! c’est impossible « Je comprends qu’il accompagne son ordre d’une poussée pour forcer son beau-père à se recoucher et qu’il y a une lutte entre les deux hommes. Suit un long silence, puis des sanglots plus ou moins contenus; grand-père était mort.
(ici revient le bic noir un peu gris, plus fin que le feutre)
Cette première vision de ma petite personne, qui spontanément s’efface, je ne m’en souviendrais peut-être pas s’il n’y avait eu le miroir du sourire de grand-mère. Certes, la situation, livrée aux grandes personnes, justifiait l’effacement de l’enfant. Mais l’effacement me parait bien être l’une des caractéristiques de toute ma vie et il me parait tout de même singulier que dans ma mémoire consciente ce soit là ma première vision de moi-même. J’ai toujours été celui qui monte le dernier dans l’autobus, le métro. En classe, si on ne m’imposait une place, j’allais dans le fond, au dernier rang. A l’école communale de mon village nous étions placés selon le résultat des compositions et des moyennes mensuelles mais au lycée nous étions livrés à nous même ainsi qu’à l’université où je me rendais invisible. J’ai même le souvenir d’un professeur qui m’avait appellé à la suite d’une dissertation pour que je fasse un exposé et, sachant qu’il ne me connaissait pas, je n’avais pas répondu. Ma volonté d’effacement allait alors jusqu’à la sauvagerie. C’est peut-être beaucoup dire pour une première image et qu’est-ce au juste que ce que j’appelle « effacement » ? Si je continue cette espèce d’autobiographie introspective, il me faudra sans doute y revenir. De l’enterrement de grand-père, je n’ai aucun souvenir. Peut-être que ma mère avait voulu m’éviter les douleurs inhérentes à ce genre de cérémonie. Au drame social que représentait la mort de grand-père dans une famille pauvre, je n’avais guère conscience, c’est seulement beaucoup plus tard que j’ai compris tout le tragique de ces derniers instants d’un homme que la vie n’avait pas gâté. Des fiançailles avec ma grand-mère en l’attente d’un mariage que des années de service militaire - dans la cavalerie- allaient retarder indéfiniment. La perte de son moulin, il aurait voulu etre architecte et j’ai encore devant les yeux le plan d’une école – un sous-verre encadré fixé au mur – il avait été meunier, puis contraint de quitter son moulin et Montigny sur pour entrer à l’usine de cuivre de La Bonneville sur Iton; c’était une vie de travail, de contraintes et d’échecs, mais il avait eu la compensation d’avoir deux enfants exceptionnels – je parlerai un jour du troisième. Quoiqu’il en soit nous nous aimions sans doute beaucoup lui et moi.
Dés le premier dimanche qui suivi son enterrement, grand-mère m’emmenait au cimetière, situé à la lisière de la commune. Et ce fut jusqu’à l’age de neuf ans la sortie de presque tous les dimanches après-midi, en toutes saison. Il n’avait pas de pierre tombale mais un parterre entouré d’une petite palissade de bois peint. Grand-mère avait donc là dans le rectangle où il reposait un petit jardin de fleurs en sortes que nous partions assez souvent avec la brouette, une binette, un plantoir et des fleurs prélevées sur notre propre jardin (dans lequel j’avais le mien), lui réservant les plus belles. A la Toussaint seulement, nous emportions de beaux chrysanthèmes métallisées achetées chez la propriétaire de la maison où il nous fallut bientôt déménager, abandonnant du même coup la maison relativement confortable avec une grande coure, un grand jardin pourvu d’une fontaine où nous allions puiser l’eau. Ma propre chambre donnait sur la coure où il y avait des poules et des lapins. Avec les légumes du potager nous étions comme beaucoup de campagnards à cette époque a peu prés assurés de ne pas mourir de faim. La maison où il nous fallut déménager sans doute parce que le loyer de l’ancienne était trop coûteux avait elle aussi une coure sur laquelle donnait ma chambre, un atelier, une cave, une grange où s’entassait le foin et qui n’était pas à nous mais où j’allais jouer, et un grand jardin dont j’avais une petite parcelle où je plantais des fleurs et enterrais les oiseaux parfois trouvés dans la campagne. Pour revenir au cimetière, j’ai un autre souvenir, celui de l’enterrement d’une tante, femme de l’oncle André. Là, j’étais présent, mais déjà beaucoup plus grand. A l’église je m’étais plutôt ennuyé ainsi que dans la montée vers le cimetière, ce n’est qu’on moment où la bierre était descendue dans la fosse et en regardant le visage tordu par la douleur de mon oncle André que je fus saisi comme jamais jusqu’alors par les sanglots, j’éclatais positivement en sanglots, j’étais aveuglé, je titubais, enfin, au retour, je repris mes esprits et dans le café où la famille s’était réunie et où je me trouvais assis à coté d’une ravissante petite cousine venue de Rouen avec sa mère – fille d’un frère cadet de grand-père qui était capitaine de gendarmerie, je me sentis tout à fait bien, délivré, heureux comme si cette crise avait agis comme une douche bienfaisante, éprouvant un rare sentiment de bien être et bien loin de tout chagrin. Cette tante devait me donner une petite compagne, ma cousine Simone, agèe de deux ou trois ans , j’en avais six, avec qui j’allais pouvoir jouer au mariage et à la poupée et qui désormais allait vivre, comme moi-même, avec sa grand-mère. Son père était le chef comptable de l’usine, elle bras droit du directeur, sa mère était l’institutrice-directrice de l’école d’Aulnay, le village voisin; l’oncle André passait tous les soirs après son travail voir sa fille.
Je me souviens qu’un jour où il me demandait ce que je ferais plus tard, je répondais: « Je serai retraité ». Mais dans cette pèche aux souvenirs à travers ces premières années ce ne sont pas les incidents de la vie quotidienne qui se détachent en premier; c’est plutôt un sentiment de la solitude, promenades solitaires à travers les forets dans lesquelles parfois je me perdais – un jour, sur un sentier à peine tracé, je vis s’approcher un renard, nous rêvions l’un et l’autre, nos regards se croisèrent, également surpris, je m’apprétais à m’écarter quand il me devança calmement, sans se presser, et je poursuivis tranquillement mon chemin; - il faut croire tout de même que cette rencontre m’a marqué puisque je m’en souviens. Mes préférences allaient à la rivière et aux ruisseaux. Je pouvais rester des heures immobile sur un pont ou couché dans l’herbe ou dans le lavoir à observer l’écoulement d’une eau transparente, le balancement des herbes, les cailloux dans le fond, cachant les cabots, les portes-bois, les épinoches et les verrons.
(ici c’est un stylo bille noir plus gras)
Mais pourquoi vouloir tout à coup évoquer un passé, le film que suggère la désagrégation des cellules du cerveau, s’écrire avant de s’abolir ? Je croyais avoir tout oublié et je m’aperçois qu’il suffit que je me mette sur cette piste pour que de partout les détails surgissent et que l’obligation où je me suis mis vis à vis de moi-même de poursuivre le vrai est matériellement impossible. Ce n’est pas du tout une question de sincérité, c’est un problème de capillarité des mots, on file sur un chemin et on s’aperçoit qu’il est relié à de multiples nervures. Je voudrais ne garder que les principales mais c’est alors le squelette qui apparaît, une feuille qui n’aurait que sa nervure principale existerait-elle ? Imaginons un arbre dont toutes les feuilles n’ont que cette nervure, alors qu’on sait qu’il n’existe pas deux feuilles exactement semblables. Je vois bien qu’il me faut choisir si je veux continuer, mais choisir est réductionniste. Dans cette opération ce ne sont pas les mots qui me manquent, l’écriture et la mémoire, ce qu’il en reste, peuvent m’aider. Je reviens, je retourne à mes cinq ans, à l’école communale, c’est vrai, je suis d’abord assis au fond de la classe dans une division à coté d’un pouilleux aux cheveux crépus qui ne cesse de dormir mais moi je veux apprendre à lire vite ce qui se fait semble-t-il tout seul, et bientôt, après un délai que ma mémoire ne me dit pas faute de repaires suffisants, je passe dans l’autre division et là c’est moi qui apprend à lire aux autres. C’est qu’il y a plusieurs divisions dans la classe, du cours élémentaire à celui du certificat d’études et que le même instituteur ne peut pourvoir à tout, alors il délègue un « bon élève » qui emmène dans le couloir d’entrée la dernière division de la classe et qui les fait anonner l’un après l’autre ou tous ensemble, et j’aime jouer ce rôle que je ne considère pas pourtant comme une promotion ou un avantage, simplement c’est comme ça, et je n’ai sûrement rien demandé. J’ai alors l’avantage d’avoir une bonne mémoire, car elle n’est sûrement pas trop encombrée; vierge en quelque sorte et ce qui me plait s’y imprime facilement. J’ai ainsi souvenir d’une page d’histoire que l’un de nous doit lire pendant que les autres suivent sur le livre, nous sommes debout, en cercle, le maître remarquant que je ne regarde pas mon livre me demande de continuer, et je continue sans regarder mon livre car cette page je la savais par cœur. Cette facilité, je la perdais très vite, vers dix douze ans, et c’est bien dommage, car la mémoire m’aurait permis d’être paresseux. J’aime cette école de campagne, et pourtant elle manque d’attraits, les garçons et les filles sont séparés, et dans les classes et dans la coure de récréation. C’est là que j’éprouve ma première indignation, dés la première année, celle de la mort du grand-père. Avant même de rentrer en classe les élèves constatent que l’un des petits garçons, sous son tablier noir, porte une culotte de filles, blanche et à festons et fendue mais fermée par une épingle à nourrice. La récré venue le malheureux est conspué par ses camarades et, rouge de honte, il sanglote et cherche à se cacher; c’est un enfant de « l’assistance », comme il s’en trouvent à l’époque, généralement « placés » dans des familles nombreuses. L’institutrice qui nous surveillait cru sans doute trouver une solution en envoyant le malheureux de l’autre coté de la grille, du coté des filles, ce qui ne fait que multiplier les quolibets. Je ne participais pas à ces braillements, je protestais, j’essayais de dire que « ce n’était pas de sa faute ». Peine perdue... J’en conservais un souvenir amer. Je pardonnais mal à ceux qui rigolaient d’être si méchants. Je comprenais seulement vaguement que l’incident pouvait passer pour drôle, mais je trouvais profondément injuste que la victime puisse être punie pour une chose dont seule la misère sans doute était responsable et j’allais répétant: »laissez le tranquille, ce n’est pas sa faute… ». Que dire de ce souvenir, je m’étonne un peu d’être sorti alors de ma coquille.
Il y avait sans doute en moi « un bon petit cœur », mais c’est sans doute parce que j’ai eu le courage de me désolidariser des braillards qui voulaient « voir sa culotte » que je n’ai pas oublié. Cela me rappelle une autre histoire de l’école, il y avait une sorte d’innocent, de Jean-françois les bas-bleus. Un jour où il rentrait chez lui, n’ayant pas l’air très à son aise, il dit à sa mère: « le maître d’école, il a fait dans ma culotte » . Ce n’était d’ailleurs peut-être pas complètement faux, car l’instituteur était sévère et on pratiquait encore les coups de règle au bout des doigts. Et cependant j’aimais l’école, l’école communale, et les enfants, du moins les petits enfants, et c’est sans doute cet espèce d’amour qui m’ a conduit à devenir instituteur après mon bac de philo; autant que le désir de gagner ma vie tout en continuant mes études. Ce « journal », ce n’est pas la recherche du temps perdu, je m’en voudrais de penser que c’est une tentative de littérature même si c’est de l’écriture, c’est de l’a-littérature, le degré zéro de l’écriture. Je ne peux d’ailleurs à la fois fouiller ma mémoire et avoir le souci d’un style mais je constate qu’il ne va pas sans tristesse de n’écrire que pour soi, qu’il y a un stimulant à chercher le lecteur, le dialogue, la communication comme s’il s’agissait vraiment de prolonger sa vie, de voler la mort, dans mon cas, ne s’agirait-il pas de lui obéir avant la lettre, de chercher à emballer un bilan dans un cahier. Innombrables sont les journaux intimes de fin de vie qui n’ont jamais été écrits si ce n’est dans le regard lointain des vieux. Je vois bien que ce qui ressurgit d’abord ce sont les moments de plus forte émotion comme le premier d’entre eux: la mort du grand-père, et que ce qui a contribué à les fixer dans ma mémoire c’est un incident fortuit, comme le sourire de ma grand-mère. L’interprétation que j’en donne aujourd’hui n’est-elle pas sujette à caution et trop subjective quand je parle d »’effacement » ? Dans l’incident, agréable, de l’élève qui montre qu’il sait le texte par cœur entre une espèce de vanité qui ne me parait pas très en accords avec une discrétion innée.
Mais ces points forts de ma mémoire enfantine pourquoi est-ce que je m’efforce aujourd’ui de les transcrire en mots ? Quelle sorte d’impulsion me pousse, quel besoin ? Au demeurant, comme le disait Marcel Arland, ce n’est pas là un besoin permanent de mon vieil age. A un certain degré d’équilibre et de sérénité, ce besoin disparait. Serait-ce simplement une façon de vivre ou de revivre, de consolider par les mots des sentiments éprouvés et abandonnés quelque part dans un cerveau qui, dit la science autant que l’expérience, va inévitablement se désagréger, auquel cas il y aurait là une entreprise de sauvetage. Mais ces instants à leur façon privilégiés n’étaient pas la trame de ma vie; elle était dans la suite des jours et non dans leurs éclairs et leurs déchirements.
A chaque automne nous faisions notre cidre, prenant notre tour d’un pressoir, qui passait d’une maison à l’autre. Un énorme tas de pommes à cidre d’espèces diverses enbaumait l’entrée de la cour . Quand le pressoir était là, c’était une espèce de fête; des pommes écrasées sortait un pur jus, un cidre doux que je recueillais dans la coupe de mes mains et qui m’énivrait. Il était ensuite mis dans des tonneaux qui me paraissaient fort volumineux; on ajoutait de l’eau prélevée à la fontaine, et venait un jour où on enfonçait la canelle et où on pouvait tirer le cidre et remplir une bouteille, opération que j’aimais faire même si, comme cela arriva parfois, il me fallait aller jusqu’au fond de la cour en pleine nuit, ouvrir la lourde porte et surveiller à tâton et à l’écoute, des doigts et de l’oreille, l’écoulement dans la bouteille.
Il y avait aussi les bouteilles de cidre bouché traitées comme du champagne et qui parfois éclataient avant qu’on n’ait pu les boire. Mais tout cela était plus saisonnier que quotidien. Il n’en reste pas moins que comme pour tout petit normand, la boisson quotidienne était ce cidre fait à la maison. J’allais chaque jour me semble-t-il à la laiterie chercher du lait avec deux pots, un pour nous, l’autre pour la voisine, une veuve de guerre, qui me récompensait en me donnant chaque semaine des sous avec lesquels j’achetais Cricri ou l’Epatant. La laiterie fabriquait aussi du beurre et des fromages; élevait et tuait des cochons, elle était pleine d’odeurs plus ou moins agréables et je me promenais librement ici où là. D’énormes chaudrons de cuivre rutilants sous les flammes, remplis de lait, les mottes de beurres, l’emballage des demi-livres dans des papiers transparents, l’eau qui coulait partout et entrainait une agréable fraicheur en été, alors qu’à l’emplacement des chaudrons brûlants il faisait bon en hiver; dans la cour, une odeur de fumier, - une odeur que je n’ai cessé d’aimer, mélange de paille, de bouse de vaches , de crottes de cheval, etc…. par contre je n’aimais pas trop l’acre odeur des souilles à cochon mais j’aimais regarder les grosses truies allaiter leurs petits cochons. Le sentier par lequel j’allais de la maison à la ferme passait par des jardins avec les poiriers en espalier adossés à des murs de torchis souvent couronnés de ravissants petits iris mauves au printemps, voir de fleurs de la passion en été. En hiver je mettais sans doute moins de temps à parcourir ce sentier qui en vérité était un raccourci car l’accès de la ferme par la route était beaucoup plus long et ennuyeux. Ce qui me frappe à travers ces évocations, c’est ma solitude. Qu’il s’agisse d’expéditions dans les bois ou le long de ma rivière, je me vois presque toujours seul. Je n’en suis aucunement malheureux mais cette solitude je la porte sur moi comme l’escargot sa coquille. Elle me protége et me fragilise. Au demeurant, je n‘en ai pas conscience. C’est aujourd’hui, avec le recul du temps que je la constate. Elle ne me coupait pas radicalement des autres. Il y avait les enfants du village et ceux de la cité ouvrière sur les pentes en hauteur du coté de la foret, cités construites par l’usine pour ses ouvriers souvent venus d’ailleurs, algériens ou marocains, et que l’on retrouvait à l’école communale et dans la cour de récréation. Il y avait souvent bataille entre ces deux groupes et le village venant du bas était souvent obligé de battre en retraite sous les vols de pierres des gars de la cité. Un jour où j’assistais à l’une de ces bagarres je reçus un gros caillou derrière l’oreille, je crois bien que je tombais sous le choc, il fallut m’emmener chez un ami de la famille, mutilé de guerre et vieux combattant, qui me fit un pansement « il aurait pu le tuer » dit grand-mère boulversée, mais le « il » n’était pas identifié, et quand ils m’avaient vu tomber ils s’étaient tous éparpillés comme une volée de moineaux. Ces « batailles » n’étaient pas bien méchantes, plutôt des jeux, et nous nous retrouvions à l’école sans acrimonie.
(ici c’est le feutre fin , très noir)
Quels étaient, dans la maison, la seconde, celle où je devais habiter le plus longtemps, de six à neuf ans – mes lieux privilégiés. Il y avait en hiver, les rêveries devant la grille de la cuisinière à charbon, je ne me lassais pas de regarder les bouillons ardents de cet enfer en perpétuel mouvement avec de temps à autre ses flammèches bleutées, spectacle qui valait – à mes yeux – en réduction, une éruption volcanique, écoulements de lave et joyaux de feu.
La table de la cuisine –salle-à-manger, pièce à vivre pour tous, était ronde et le plus souvent recouverte d’une toile cirée, au milieu trônait la lampe à pétrole à abat-jour avec son tube de verre, sa mèche, son vase de verre à travers lequel on voyait le niveau du pétrole dans lequel trempait la mèche. C’est à cette lueur, sous cette lumière que je faisais mes devoirs et que je fis mes premières lectures : Fantomas et les Misérables en fascicules. Ils étaient prêtés à mon oncle Fernand, le dernier fils de grand-mère, par un de ses amis. Il y avait aussi les livres reçus en juillet, au moment des Prix, reliés en rouge et dorés sur tranche. La lecture me semble-t-il avait un autre impact que la réalité. Dés le soir venu, c’était le silence avec l’obscurité. Il me semble que ces années d’enfance sont des années de silence ponctuées par les battements de la grosse horloge à poids qui aussi sonnait les heures. Bientôt, je reçus des livres envoyés par ma mère, des livres pour les enfants. J’avalais n’importe quoi avec délice. Grand-mère était là, occupée à coudre le plus souvent ou à surveiller la cuisine. Elle lisait le journal « le petit parisien », ne manquait pas le feuilleton qu’elle découpait parfois et dont elle faisait des cahiers qu’elle prêtait à sa voisine. Il n’y avait pas de bibliothèque municipale, j’aimais lire ainsi dans le cercle de la lampe, le reste de la pièce baignant dans le noir jusqu’au moment où le sommeil me gagnait et où j’allais me coucher.
Un autre lieu privilégié à mes yeux était le grenier auquel on accédait par une échelle extérieure, dans la cour, et sur laquelle je ne me privais pas de grimper quand je savais que grand-mère ne me verrait pas. le grenier était une fourre tout de vieilles malles remplies de catalogues, de bouquins, de revues, et de divers objets étéroclites. C’est là que feuilletant quelques Almanach (Vermot ou autre) je tombais sur l’image d’un homme bouc aux pieds fourchus, des cornes sur le front, bref une image du diable. J’avoue qu’elle me donna le frisson car je ne doutai pas que des êtres semblables puissent exister – ce qui me permet de comprendre combien le bon peuple du Moyen-Age devait être effrayé par les représentations de l’enfer et les gargouilles des églises… Ce diable était proprement fantastique et pour le revoir j’étais prêt à me damner, l’inconvénient c’est que la lumière n’entrait que par un vasistas ou par la porte si on la laissait ouverte.
Un beau jour, après qu‘on ait planté des poteaux électriques tout le long de la route, une lumière blanche et froide tombe brutalement du plafond. Cela ne changea guère mes habitudes, mais je perdis une part du plaisir que j’avais à lire. Plus d’intimité, toute la pièce était éclairée. C’était le début d’une ère nouvelle… Dans mes lectures, j’avais tout de même des préférences, une édition des Mille et une nuit, les comtes d’Andersen, etc… Je reçu un livre de Prix dans lequel les oiseaux parlaient qui m’enchanta et que j’aurais aimé retrouver. Je n’ai aucun souvenir de Fantomas, sauf peut-être de frayeurs, alors que je me souviens des Misérables, jamais relu.
Pendant toutes ces années d’enfance villageoise de Paris ma mère ne me perdait pas de vue. Comme je grandissait vite et que j’avais une scoliose de la colonne vertébrale, elle me fit donner des leçons de gymnastique et coucher sur une planche de la dimension du lit. Je devais manger des grillades. Elle me faisait donner des leçons de piano par une vieille dame et chaque jeudi après-midi j’attendais que passe dans la rue l’élève qui me précédait dans l’horaire des leçons, une belle jeune fille de 12 ou 13 ans, toujours joliement habillée et qui venait à pied de sa belle demeure à deux ou trois kilomètres de là. On marchait beaucoup à cette époque là. Ces leçons de piano dont je n’ai rien retenu ne m’enthousiasmaient et mon amour pour la belle jeune fille inaccessible allait rejoindre les comtes de fées d’Andersen…
Déjà dans ces jeunes années, il y avait l’amour, toujours tourné vers les filles et il y avait le sexe. Le premier me tourmentait plus que le second . J’avais au printemps des envolées de cœur pour des filles généralement plus agèes que moi. Il y eu la sœur d’un camarade de classe, je priai son frère de lui déclarer que je l’aimais, je fixais même un rendez-vous derrière l’église, où elle vint, l’air plutôt boudeur, et comme je ne savais que faire d’elle, que la conversation était courte, cette première affaire n’eut pas de suite. Une autre alla plus loin avec une fille plus grande, on alla se cacher dans un grenier pour s’embrasser et se tenir la main et en rentrant tout échauffé je dis à grand-mère que quand je serais grand j’épouserais Juliette (était-ce bien son prénom ?) . Dés qu’il y avait amour , le sexe s’effaçait. Le mien de sexe s’émouvait assez facilement mais comme par hasard- en m’appuyant sur le parapet du pont par exemple alors que j’éssayais de discerner les truites à contre courant sous les reflets de l’eau, je fus saisi au bas ventre par une sensation agréable suivie d’une érèction . Ce n’était pas la première et j’eus tendance à la renouveller par le même procédé, c’est à dire sans me toucher. Revient pourtant un drole de souvenir. J’avais entendu dire que le berger avait des rapports avec ses chèvres et l’un de mes camarades prétendait même l’avoir surpris en train d’en enculer une . Sa mère était veuve et travaillait au dehors en sorte qu’il était souvent seul . Il m’invita un jour à venir dans sa basse-cour et me montra comment il enfilait ses poules pondeuses en leur tordant le cou pour qu’elles n’ameutent pas le voisinage. Plus vieux que moi, il alla jusqu’à éjaculer par ce procédé un peu particulier dans lequel malgré mes efforts il me fut impossible de l’imiter. J’étais d’ailleurs plus curieux que véritablement intéressé mais pour que je m’en souvienne il faut que cet incident ait marqué plus ou moins le tissu quotidien.
J’aurais pu satisfaire aisément mon épisodique curiosité envers l’anatomie du sexe féminin en observant ma petite cousine mais je n’y songeais pas; par contre je demandais un jour d’été à une petite drôlesse de me montrer son zizi; elle voulut bien y consentir à la condition que je lui montre en même temps le mien, ce qui fut fait, elle soulevant sa jupe je découvris qu’elle n’avait pas de culotte et moi en ouvrant ma braguette. Plus curieuse que moi, elle tendit la main pour toucher, ce que je me laissais pas faire, car de mon coté j’étais plutôt déçu par la petite fente et ce, d’autant plus que nous étions tous deux debout. Si je cherchais bien je trouverais peut-être d’autres souvenirs du même ordre, je n’en vois guère l’intérêt pour le moment. Je dépendais beaucoup des lettres de ma mère, espérant toujours la visite de mes parents. Un Dimanche matin grand-mère me déclara qu’elle avait rêvé de carottes et que cela pouvait signifier que mes parents allaient venir. Je filais aussitôt à la gare. Mais au train de Paris, il n’y avait personne et ma désillusion fut seulement un peu plus grande qu’elle n’eut été sans ce maudit rêve dont l’interprétation demeure bien mystérieuse … Charitable invention peut-être pour répondre à une attente sans trop se compromettre mais ébauche d’une prouesse qui avait peu de chances de se réaliser. Il leur arrivait aussi d’arriver sans prévenir. Nous n’avions pas le téléphone, encore rare à l’époque, il fallait aller à la poste, et d’ailleurs, mes parents non plus n’avaient pas le téléphone. C’est encore une de ces nombreuses invention survenue au cours de ma vie et qui ont changé bien des choses. Mon père m’apporte un jour ma première T.S.F, un poste à galène, petite pierre luisante sur laquelle il fallait poser en tatonnant une pointe métallique à ressort, les écouteurs sur les oreilles. Pas de quoi modifier mes habitudes ni révolutionner mon emploi du temps mais ce qui me frappait c’est qu’une musique invisible pouvait traverser le ciel et venir jusqu’à moi. Une après-midi d’été marchant seul sur la grand route, je perçus soudain une extraordinaire symphonie. D’où pouvait-elle venir ? La route était déserte, pas même une voiture. Seuls, les fils électriques et peut-ètre télégraphiques pouvaient en être la source. Cette musique me poursuivait, me bourdonnait dans les oreilles. Je m’éloignais de la route prenant un sentier à travers bois. Si la musique cessait ce serait la preuve qu’elle venait des fils; mais elle ne cessa pas, même dans la foret… d’où venait-elle? Elle était dans ma tète et pourtant, je la percevais comme extérieure. Les promenades en foret n’étaient pas sans risque, un jour je marchai sur un essaim d’abeilles.
Elles se ruèrent sur moi et je fus criblé de piqûres surtout sur la figure, les jambes et les mains. Je rentrai chez moi en courant, on fit venir le docteur, une trentaine de piqûres; de quoi me vacciner pour la vie … Il y avait aussi les guêpes et les frelons dont on disait que sept piqûres suffisaient à tuer un homme. Pourtant, dans mes nombreuses équipées solitaires je ne m’inquiétais pas des piéges de la nature. J’allais assez souvent faire un sac d’herbes pour les lapins et après la moisson, j’allais glaner le blé dans les champs, au-delà des bois, ramenant des bottes pour les poules. J’aimais me mettre à l’abris du soleil sous les grandes gerbes disposées en faisceau et formant comme une tente de peau-rouge. Dans la foret, je faisais des cabanes. La plupart des grottes en lisière étaient habitées par de vieilles femmes seules et un marchand de balais. J’allais ramasser les nèfles au début de l’hiver et les étalais devant ma fenêtre pour les manger quand elles seraient pourries ou gelées. Nous allions aussi aux merises, petites cerises noires qui poussaient sur des arbres géants très hauts pour moi et sur lesquels je ne me risquais pas à grimper. Les pommiers étaient moins dangereux, je mâchais la pulpe pour en extraire le jus et la crachais ensuite. De même, en les frottant entre les mains, je dégageais les grains de blé de leur enveloppe, et je les mâchais jusqu’a en faire une pâte, une espèce de boule de chewing-gum que j’appréciais beaucoup. Il y avait la saison des fraises des bois, des mures, des champignons des bois et des prés; il fallait connaître les endroits et savoir les retrouver. Au fond, je faisais un assez bon petit sauvage, un bon petit galopin de village normand.
(ici un démarrage au bic bleu, immédiatement suivi d’un bic noir, avec en marge cette note entourée: tel. De Simone : elle est chez grd-mére de 2 ans ½ à 5 ans c’est à dire que j’ai 6 ans quand elle arrive . André mort le 9 aout 1972, grd-mére en 5O)
Mon père. Un jour grand-mère, l’air grave me dit: « ton papa est très malade, nous partons à Paris. »Elle semble bouleversée. J’ai dix ans. Je suis long et maigre. Je porte sur le monde un regard étonné mais toujours prêt à m’adapter aux situation, heureux ou accablé. Je n’ai pas oublié la mort de mon grand-père « être très malade » elle veut dire « mourir bientôt ».
Je le vois sur son lit. Il a des marques sur la nuque « méningite » dit-on. Il ne me reconnaît pas. Je n’ai pas souvenir qu’il ait ouvert les yeux. Grand-mère et moi sommes descendus dans un hôtel prés de là. Un matin maman arrive, en robe de chambre à fleur elle a traversé la rue, elle me sourit, elle parle à grand-mère. Le lendemain; on m’embarque pour Saint Quentin avec un couple d’amis qui n’ont pas d’enfant mais un petit chien blanc. Ils tiennent un grand café sur la place. La ville a été détruite par la guerre. Il y a des mines partout et d’énormes entonnoirs pleins d’eau croupie; La encore je trouve bientôt mon bonheur au bord d’une claire rivière. C’est l’été, les grandes vacances. Je chante « Dans les jardins de l’Alhambra » je joue avec des garçons du voisinage. L’un d’eux me dit un jour gentiment , je ne sais plus comment ni pourquoi : « tu sais que ton père est mort » . Je réponds « oui je le sais » . En fait , sans que rien fut dit, je le savais depuis l’instant où maman était apparue moulée dans sa robe de chambre à fleurs, échevelée, tremblante. J’avais aussi surpris des conversations nocturnes de mes hôtes car je couchais dans un lit-cage blanc dans leur grande chambre. Le pays dévasté, quoique en pleine reconstruction, la chaleur et la poussière de l’été, le fait que j’étais loin de tout parent proche ne semblait pas m’abattre. J’allais chercher le lait chaque soir dans une ferme assez éloignée. Un soir où la fermière était occupée, en l’attendant sur le seuil de la porte de la cuisine, alors que je jouais avec des petits chiots noirs, leur chienne de mère, énorme, se jette sur moi, me plante ses crocs sur le coté droit et je crus qu’elle allait me dévorer. Entendant mes hurlements la fermière accourut et flanque une volée de coups de bâtons à sa chienne puis entrepris de me soigner. Ma chemise était déchirée, les crocs avaient pénétré dans la chair, je fus bien obligé de dire ce qui m’était arrivé.
En fait, j’avais bien peu de souvenirs de mon père. Quand mes parents m’avaient quitté, me laissant à la campagne avec ma grand-mère, j’avais deux ans et demi et ne m’en souviens pas. Ils venaient parfois, pas souvent, me voir, et j’ai plus le souvenir d’avoir espéré qu’ils viendraient, et de les avoir attendus en vain devant la gare de La Bonneville , monté pour mieux voir sur les troncs d’arbres entassés avant d’être chargés sur les wagons de marchandises. Le village, serré sur sa rue principale qui le traversait me paraissait morne; la vie commençait à m’intéresser dés que je franchissait la rivière et que disparaissaient les maisons. Si j’ai quelques souvenirs de mon père, je doute qu’ils méritent d’être mentionnés. Il avait une mèche brune sur le front et de grands yeux noirs, sous des sourcils épais, il parlait avec l’accent du Nord, il adorait ma mère qui le rabrouait facilement. Il était bon et il m’aimait. Il m’a parfois, au moins deux ou trois fois emmené dans son village natal prés de Valenciennes où vivaient son père et sa mère, des grands parents maternels, un frère, des sœurs, et il nous fallait passer de l’un à l’autre, manger des tartes à la casonnade. Son frère qui tenait un bistrot et qui avait l’air d’un espagnol avait dans la salle du café un grand phonographe à pavillon qui m’étonnait plus que le reste. Les traces de la guerre - de 14-18- étaient là aussi visibles, non seulement dans les ruines mais même dans les nouvelles maisons de brique rouge, maisons de mineurs monotones, toutes semblables, et dans les survivants, souvent gazés, ou mutilés.
Mon grand-père était mineur, il remontait tout noir de la mine et sa femme le lavait à l’eau chaude dans une grande bassine de zinc. Il avait donc survécu à la guerre. Mais il en avait tellement souffert que lorsqu’il vit de nouveau les Allemands en 1940, il se suicida en se mettant un canon de revolver dans la bouche, je l’appris par une lettre d’une sœur de mon père, Evelina, qui avait tenu à me réserver ma part d’héritage et m’avait recherché.
Un souvenir me revient, où je crois retrouver la fierté et le bonheur de mon père d’être avec son petit garçon. Nous sommes dans le train, enfermés dans notre compartiment. Le train s’arréte en pleine campagne. Au bout d’un moment je me dresse sur la banquette, et de toutes mes forces, je pousse, les deux mains en avant appuyées sur la paroi et dis : « avance ! ». Ce qui fait rire tout le monde. Je dois avoir cinq ou six ans. Mon père avait commandé une paire de chaussure à un cousin cordonnier. Chaussures montantes jaunes, assez souples, très belles. Il avait bien pris mes mesures mais il ne les avait livrées qu’au bout de plusieurs mois et quand je les mis à mon pied déjà elles étaient justes. Bientôt, elles me firent mal mais je préférais souffrir que de le dire. Il faut croire néanmoins que grand-mère s’en aperçut car elles disparurent assez vite.
(évidemment c’est ambigu de te restituer ces pages passées ds la mouture de l’ordinateur qui suggére une pseudo-édition par la forme …et le coté »officiel » de tout texte typografié . Mais c’est une façon , je l’éspére de t ‘encourager à considérer cette forme d’écriture ( a-littérature dis –tu pour te dédouaner d’avance) com tout aussi noble qu’une autre , avec son public (a-littéraire c’est éxacte car pas le propos … mais ça éxiste qd méme CE public là !!! n’en déplaise à tes névroses « proféssionnelles » ? )
suite bienvenue ….
(une note au crayon sur un papier glissé ds le cahier m’avait échappé :)
Je me suis « converti » à la peinture à l’huile. Cela signifie quoi au juste ? Répondre aux nécessités d’une exposition? Je ne crois pas vraiment. Mais peut-être secrète volonté de « durer », de consolider le tombeau.
(plus une carte postale graphique : Autumn Leaves , West 69th Street from Central Park , New York City.
Your purchase of this card is a contribution toward new trees for West 69Street.
“Chére Béatrice et André I hope you had a very successful trip . Do get all my love and best wishes for Cx and next year.Lost of love Jacqueline.

Sur la couverture du Cahier.
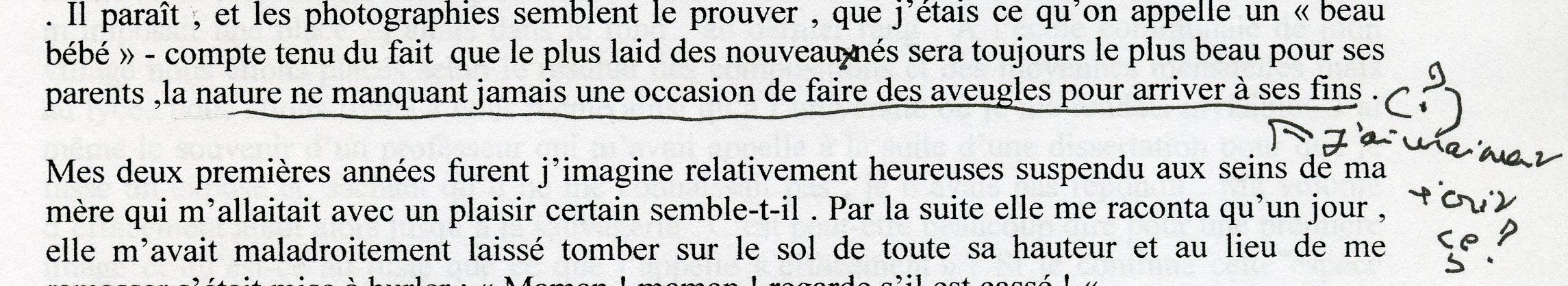
© Didier BAY 16.09.2016